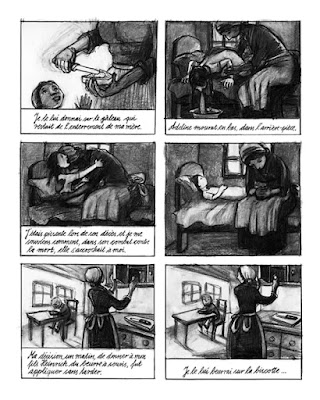Belle comme un mirage, une hallucination, un rêve rimbaldien.
Ce tome contient un récit de nature biographique, relatant quarante-huit heures de la vie d’Ava Gardner. Son édition originale date de 2024. Il a été réalisé par Emilio Ruiz pour le scénario, et par Ana Miralles pour les dessins et les couleurs. La traduction a été réalisée par Geneviève Maubille, avec une relecture assurée par Murielle Briot. Il comprend cent pages de bande dessinée. Il commence par un texte d’introduction d’une page, rédigé par Elizabeth Gouslan, autrice du livre Ava, la femme qui aimait les hommes (2012). Elle évoque la beauté inouïe de l’actrice, qualifiée de Plus bel animal du monde par Jean Cocteau, la couleur changeante de ses yeux, le film La comtesse aux pieds nus qui s’inspirent de sa vraie vie, et sa relation avec Frank Sinatra.
Le sept septembre 1954, à Rio de Janeiro, le film La comtesse aux pieds nu est à l’affiche. Dans son beau costume blanc, Gilberto Souto contemple la marquise de l’Odéon qui porte le nom des acteurs et du réalisateur. Avec les journaux sous le bras, il regagne ses bureaux, où il est accueilli par sa secrétaire Belem qui lui indique qu’elle a l’agent d’Ava Gardner au téléphone. Il lui demande de lui passer l’appel dans son bureau. Souto rassure David Hanna : L’hôtel Gloria est magnifique, il est parfait pour une star telle qu’Ava Gardner. Il continue : Certes le Copacabana Palace est plus réputé, mais il est aussi moins sûr, et la situation du pays est telle qu’ils doivent avant tout veiller à la sécurité de Miss Gardner. En réponse à un question, il indique que tout est en ordre, qu’il vient de s’entretenir avec le chef de la police. En effet la venue d’Ava risque d’attirer beaucoup de monde, et on est à Rio. Hanna doit comprendre que cette ville n’est pas Lima ni Buenos Aires, encore moins Montevideo. Les Cariocas n’éprouvent pas simplement de la passion pour Miss Gardner, c’est carrément de la frénésie ! Il termine la conversation avec une recommandation : quand ils atterriront à Galejão, ils ne doivent pas descendre de l’avion, avant son arrivée.
Belem, la secrétaire, rentre dans le bureau alors que Gilberto Souto a commencé à lire les journaux. Elle l’informe que M. Krymchantowsky a appelé pour organiser la journée avec les hommes d’affaires, que les responsables du festival de poésie aimeraient savoir si Ava accepterait de réciter quelques vers en portugais lors de la cérémonie de remise des prix. Souto lui indique qu’il faudra prévenir les journalistes et l’hôtel que l’avion atterrira avec du retard. Puis il enfile sa veste et lui indique qu’il se rend à l’ambassade demander des passeports diplomatiques, car l’actrice et son agent veulent se rendre directement à l’hôtel sans passer par la douane. Qui ne tente rien n’a rien… À bord de l’avion, Ava Gardner répond aux questions d’un journaliste. Que dirait-elle aux lecteurs de la Ava Gardner qui fait la une des journaux ? Sa réponse : Qu’elle ne correspond en rien à la femme qu’elle est en réalité. L’image que la presse donne d’elle l’attriste beaucoup. Question suivante : Pourquoi Ava Gardner ne conteste-t-elle jamais ces fausses informations ?
Irrésistiblement attiré par la magnifique couverture, le lecteur se retrouve impuissant face à la promesse de passer du temps avec cette actrice hors du commun, ou par celle de retrouver les planches tout aussi extraordinaires d’Ana Miralles, après la série extraordinaire Djinn (2001-2016, treize tomes et trois hors-série), scénarisée par Jean Dufaux. L’expression d’Ava est indéchiffrable sur la couverture : un moment paisible hors du temps, un instant d’attente entre deux prestations à se donner en spectacle, ou une forme de résignation en train d’évoluer vers l’acceptation. Le lecteur aura la satisfaction de découvrir les circonstances de cette pause, ainsi d’avoir une vue plus large sur le lieu. Il focalise ensuite son attention sur le sous-titre : il s’agit de suivre cette beauté féminine pendant un court laps de temps : quarante-huit heures. L’introduction fournit des éléments de contexte intéressants pour celui qui découvre cette actrice : sa beauté inouïe, les réalisateurs avec qui elle a déjà tourné (John Ford, Henry King, Gorge Cuckor, John Huston, Nicholas Ray) et récemment Joseph Mankiewicz, la raison pour laquelle elle se rend à Rio de Janeiro. La planche d’ouverture contient déjà toutes les qualités du récit : différents endroits de Rio de Janeiro, la reconstitution historique, les personnages élégants, la curiosité de savoir comment va se dérouler ce séjour, à quoi va être confronté Ava Gardner, comment elle va se comporter par rapport à ce qui est attendu d’elle.
C’est donc l’occasion de réaliser une visite touristique à Rio de Janeiro. Le lecteur se plaît autant à prendre le temps de laisser son regard lors des scènes en extérieur, que lors de celles en intérieur. Il rentre donc avec Gilberto Souto dans les locaux de son agence : bureaux en bois, chaises en bois, classeurs métalliques, affiches au mur, sous-main, lampe de bureau, tout est d’époque. Une fois passé la fin du voyage en avion et la douane, il prend le temps d’apprécier la décoration de l’hôtel Gloria : le tissu des larges fauteuils, les dorures de la salle de bain, le mobilier épuré dans la chambre, le grand hall de l’hôtel avec l’estrade qui a été installée et les tentures bleues. Il peut ensuite comparer avec la décoration de l’hôtel Copacabana Palace : sa piscine qui fait envie, les tables plutôt rondes que carrées et leur nappe, le magnifique lobby, la chambre aménagée avec plus de retenue, le balcon et sa vue extraordinaire sur l’océan, etc. Les décors en extérieur coupent le souffle du lecteur : le trajet en voiture de Souto pour rejoindre l’aéroport ce qui laisse le temps de regarder les façades, la perspective sur l’océan alors que l’avion achève sa descente vers la piste, la vue de la baie avec la monumentale statue du Christ rédempteur, la virée nocturne de Rene dans un autre quartier de la ville, et une virée nocturne exceptionnelle d’Ava et David qui les emmène au pied de la statue du Christ rédempteur, durant une dizaine de pages.
L’artiste s’implique pour une reconstitution historique présente dans chaque élément : les accessoires du quotidien, les modèles de voitures, les robes d’Ava Gardner et ses gants, les sous-vêtements de Rene, les costumes de de ces messieurs, sans oublier les chapeaux et les cravates unies ou à motif, etc. Bien sûr, la dessinatrice soigne la ressemblance physique d’Ava Gardner, et la délicatesse de son trait convient à merveille à la pureté du visage de l’actrice, à sa silhouette gracieuse, et à ses gestes étudiés. Le lecteur peut la voir resplendir par comparaison aux autres personnages féminins, quel que soit leur degré de beauté. Il admire le maintien des hommes, souvent splendides dans leur costume formel. La qualité de la narration visuelle s’exprime également dans le naturel de chaque prise de vue, dans leur évidence et leur plausibilité. Le lecteur peut voir comment Ava Gardner joue avec le journaliste dans sa cinquantaine, lors des questions posées pendant le voyage en avion. Il apprécie l’écho qui se produit lors d’une séance d’interview beaucoup plus inquisitrice face à plusieurs journalistes, et l’actrice qui déploie tout son savoir-faire en matière de charme et de séduction. Il sent la tension monter lors du face-à-face avec Howard Hughes dans la chambre d’hôtel, alors qu’il se montre de plus en plus pressant. Il découvre les circonstances correspondant à l’illustration de couverture, et il ressent une forte empathie au vu des émotions qui secouent Ava Gardner.
Au bout de quelques pages, le lecteur peut trouver la narration un peu trop factuelle, un peu explicative comme si le scénariste prenait bien soin d’éviter toute incompréhension. Il suit une femme que l’on peut qualifier de beauté fatale, soumise à l’incroyable pression créée par l’attente de tous ses admirateurs. Il ressort comme elle meurtri de la sortie d’avion pour rejoindre la douane : scénariste et artiste réalisent une séquence oppressante et claustrophobique au cours laquelle l’actrice se retrouve assaillie par une foule compacte au sein de laquelle chacun veut la toucher créant ainsi un mouvement d’écrasement terrifiant. Il prend pleinement fait et cause pour cette femme qui a besoin d’être plus que l’image publique que tout le monde exige d’elle tout le temps. Il comprend parfaitement qu’elle ait besoin d’évacuer cette pression, qu’elle ait des mouvements d’humeur… même s’il lui conseillerait d’y aller mollo sur le tabac et l’alcool.
En progressant dans le récit, le lecteur se rend compte que le scénariste a tout annoncé dans les premières pages : les relations compliquées avec les hommes, une femme réduite à une image publique parfaite, le fait qu’elle ne conteste jamais les fausses informations, etc. Tout est là. Il découvre alors que le récit va au-delà de ces éléments attendus. La virée nocturne de David & Ava exprime avec force le besoin de liberté, de sortir des apparences attendues. Il comprend le pourquoi d’une séquence dans le passé avec son père qui lui dit que : Les poupées ne sont pas idiotes, elles savent se débrouiller. Une métaphore sur l’image de poupée d’Ava, qui ne veut certainement pas finir comme celle qu’elle a eu étant petite. La réception d’Ava Gardner s’inscrit également dans un contexte politique et social très concret. Le lecteur ressent également de l’empathie pour Mearene (Rene) Jordan la dame de compagnie de l’actrice, et il s’insurge contre le piège qui lui est tendu. Il commence par sourire en voyant comment certaines personnes essayent de tirer profit par tous les moyens de la présence de l’actrice célèbre, y compris par des moyens malhonnêtes. Il se rend compte que la réflexion va plus loin, en mettant en scène comment cette femme représente Hollywood, c’est-à-dire à la fois l’impérialisme culturel américain et la richesse financière hors de proportion avec la réalité des habitants du Brésil. Ce qui induit une différence de situation sans comparaison possible entre des individus faisant tout ce qu’ils peuvent pour améliorer leur ordinaire avec les moyens dont ils disposent quelle qu’en soit la légalité, dans une société fonctionnant sur la débrouille et la corruption, par opposition à une femme courtisée par tout le monde, prisonnière de son image et du rôle que les autres lui imposent, dans lequel ils la cantonnent, malgré son aisance financière.
C’est un plaisir ineffable que de retrouver l’élégance de la narration visuelle d’Ana Miralles, son implication extraordinaire dans l’élégance et la reconstitution historique, sa justesse dans la narration visuelle. Venu pour partager deux jours dans la vie d’une actrice magnifique, le lecteur se retrouve à endurer les conséquences de sa beauté incomparable qui la réduit à un objet du désir pour la foule, ainsi que la convoitise qu’elle suscite en tant qu’incarnation de l’impérialisme américain.