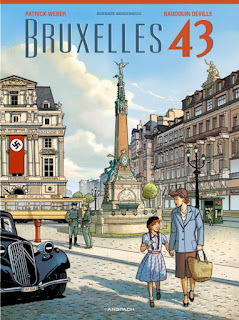On ne conquiert pas le sable.
Ce tome fait suite à Croisade - Tome 6 - Sybille, jadis (2011) qu’il faut avoir lu avant. Les quatre premiers tomes forment le cycle appelé Hiérus Halem. La parution de celui-ci date de 2013, et c’est le troisième du second cycle appelé Nomade, qui compte également quatre albums. Il a été réalisé par Jean Dufaux pour le scénario, et par Philippe Xavier pour les dessins. Les couleurs ont été réalisées par Jean-Jacques Chagnaud. Il compte cinquante-deux planches de bande dessinée.
La petite troupe de Sarrazins n’était plus qu’à une journée de marche de Hiérus Halem. La ville sainte. Ils s’étaient arrêtés pour la nuit et commençaient à croire au succès de leur mission. Toutes les précautions semblaient prises. Du moins, Sheber, le chef de l’expédition voulut s’en assurer. Il fait le tour des sentinelles. À la première, il demande comment va le prisonnier. Réponse : le philtre agit toujours, mais il a commencé à bouger. Sheber s’en étonne : déjà, c’est plutôt que prévu, tant pis ! Ils repartiront avant l’aube. Cela va leur gagner quelques heures. Et il s’éloigna, plutôt rassuré. Il pouvait encore croire en sa chance. Ce qu’il ignorait, c’étaient les ombres qui avançaient lentement vers la palmeraie. Et soudain tout alla très vite, et la chance le quitta à jamais. Sheber n’eut même pas le temps de combattre. En quelques instants, le campement fut aux mains des chrétiens qui avaient massacré tous les sarrazins avec des flèches et à l’épée. Ils cherchaient quelque chose de précis.
Dans une tente à l’écart, les chrétiens découvrent le prisonnier qu’ils cherchent : un individu entravé et masqué. Le chef exige de voir son visage. C’est bien le maître des flagellants. Ce dernier ouvre la bouche et une nuée noire meurtrière s’en échappe : le Simoun Dja ! Jusqu’à son dernier souffle, alors même que sa tête roulait au sol, il a craché une fumée noire s’élevant au ciel. Un peu plus tard, dans une citadelle forteresse des croisés, Renaud de Châtillon écoute ses commandants, son conseiller spirituel et Gauthier de Flandres. La rumeur disait donc vrai : les flagellants sont atteints d’une maladie mortelle. Maladie qui se répand comme la pestilence et qui emprunte ses sortilèges au fléau du Simoun Dja, ce vent du désert qui désosse les plus braves. Gauthier de Flandres ajoute : Le seul à pouvoir répandre cette peste, à commander au Simoun Dja, est un monstre, une âme tellement noire et vile que les infidèles lui prêtent un pouvoir ancestral, plus vieux, plus puissant que toutes les légendes, aussi anciennes soient-elles. Jurand de Poméranie souhaite savoir qui a commandé cette mission. Guy de Lusignan, comte de Jaffa, l’homme le plus laide de la Terre, fait son entrée dans la pièce et indique que c’est lui qui l’a commandée.
Fin du tome six, Gauthier de Flandres rejoignit la caravane de Renaud de Châtillon qui partait pour la ville sainte. La ville où reposait le vénéré X3. La ville où le Qua’dj rampait dans les ténèbres. La ville où les nomades doivent mettre un genou devant la croix. De manière inattendue, ce tome commence tout autrement : une attaque de croisés sur un groupe de musulmans. Finalement il n’est pas donné à Gauthier de Flandres de rejoindre la ville sainte, et il reste un nomade, conformément au titre de ce cycle. Il se retrouve une fois encore un acteur dans cette guerre de religion, un Français en pays arabe, un individu devenu athée au milieu de croyants, un nomade sans foi, mais respectueux des lois, et un amoureux transi. Il dispose même de son fidèle compagnon, personnage peu développé mais toujours présent à ses côtés, car immortel. Tellement présent qu’il a déjà observé Gauthier en train de faire l’amour avec une femme. Il se retrouve une fois encore en position de personnage principal et de héros : conseillant les puissants pour établir la vérité, se portant volontaire pour une mission à haut risque, tenant tête aux puissants malgré le risque pour sa personne, se faisant violemment tabasser (deux fois même), voyant deux compagnons tomber au combat, devant se tenir face à la femme qu’il aime, mais qui vit avec un autre. Peu de choses lui sont épargnées, ce qui ne l’empêche pas de continuer, d’aller de l’avant, de se lancer dans de nouvelles explorations. Le lecteur est de tout cœur avec lui.
L’intrigue semble prendre un chemin de traverse, s’éloignant une fois encore de Hiérus Halem. Pour autant, elle fournit également l’occasion de revenir vers des personnages récurrents de la série comme Syria d’Arcos et Ab’dul Razim, ou encore le mufti d’Alkar, de faire connaissance avec Guy de Lusignan annoncé dans le tome précédent, et avec le vizir Zalkan, et de s’enfoncer encore un peu plus dans sa mythologie avec les flagellants que le lecteur avait vu passer dans le tome deux, proches de la porte de Samarande, se préparant à fêter le Kum Dirvha. La guerre de religion entre les Sarrazins et les croisés français reste au cœur de la dynamique du récit. Gauthier de Flandres reste une quantité inconnue et incontrôlable parce qu’il s’est affranchi de l’Église constituée, trop conscient de l’instrumentalisation de la Foi pour servir une soif de conquête, l’ego de conquérants, d’un côté comme de l’autre. La libération du Simoun Dja dans la première séquence montre que n’importe quel croyant peut être infecté par une interprétation déviante de la Foi, l‘amenant à commettre des actes allant contre la morale chrétienne. La seconde séquence montre un individu physiquement marqué par la guerre, avec une blessure continuant à suppurer, faisant en sorte d’imposer sa volonté par la force, une autre déviance par rapport à la parole sainte. Puis le vizir de Hiérus Halem choisit de répondre à l’attaque par une exécution publique : un retour en arrière à la loi du talion. Gauthier de Flandres se retrouve alors en position d’aller débusquer le Qua’dj parmi les flagellants, c’est-à-dire trouver la racine du Mal, l’entité qui corrompt l’âme des hommes. Un fois parmi cette communauté, il doit faire face à une autre forme d’interprétation délirante du Credo, un autre fanatisme, cette fois-ci de nature mystique. De son côté, Syria d’Arcos va elle aussi chercher une aide auprès d’un mystique, qui lui aussi en profite pour manipuler son interlocutrice afin de mettre la main sur un objet de pouvoir pour avancer dans sa propre quête mystique, là encore avec une intention de domination.
Les dessins semblent avoir évolué, intégrant à la fois l’efficacité narrative des premiers tomes, et une représentation avec des traits de contour plus délicats issue du tome précédent. Ainsi la première case présente la vision d’une oasis dans une case de la largeur de la page : des traits fins pour délimiter des formes rendant plus compte de l’impression produite par chaque élément, arbres, roches, sable, que d’une description fine qui permettrait par exemple d’identifier l’essence des arbres. La case est admirablement complétée par la mise en couleur qui vient se faire détacher chaque plan par rapport aux autres, rehausser le relief de chaque élément, installer l’ambiance lumineuse de la nuit bleutée. Le lecteur retrouve la délicatesse et l’attention aux détails dans des éléments spécifiques ou dans des compositions mémorables : la finesse d’une cotte de mailles, la texture de la fumée noire du Simoun Dja, la beauté délicate du visage de Sybille d’Aubois, la magnifique vue en élévation du jardin intérieur de la demeure du diplomate Armand de Gésard (le bassin, la forme des massifs avec leur bordure végétale), les broderies de la magnifique robe du sultan Ab’dul Razim, les chaines et les bracelets au métal corrodé dans la geôle, l’étonnante formation rocheuse appelée Les portes de la sainte foi, les tentures avec les superbes calligraphies arabes dans l’église délabrée d’Entéaclon, la cire des cierges, Hiérus Halen dans le lointain avec ses fortifications, et l’architecture très particulière du Jebel Tarr, la cité des flagellants.
L’histoire apparaît avant tout comme une aventure, avec ce héros libre et indépendant, des passages spectaculaires : l’attaque du camp dans l’oasis, la révélation de l’apparence de Guy de Lusignan qui évoque celle d’Akhabah le maître des Machines, la tête coupée du diplomate Armand de Gésard, la pluie de flèches aux portes de la sainte foi, les rites de la communauté de frère Entéaclon, etc. Dans le même temps, le récit s’avère riche en questionnements sur la Foi, sur les différentes formes de fanatisme plus ou moins prononcé, sur les motivations du personnage principal, entre quête spirituelle personnelle et sens de l’honneur, sur l’investissement de l’individu dans un système de croyances, le pouvoir que ce système peut donner à certains, la légitimation qu’ils en tirent, le fonctionnement qui en découle pour une communauté, ou pour un peuple. Chaque chef promeut une idéologie spirituelle avec des conséquences temporelles, qui s’avèrent aussi contraignantes pour lui que profitables. Pauvre Osarias, ressuscité à chaque mort, obligé d’être le témoin des événements, souffrant tout autant que les autres, mais avec un libre arbitre quasi inexistant.
En entamant ce tome, le lecteur commence par se demander ce qu’il est advenu de l’intention de rallier Hiérus Halem par les croisés menés par Renaud de Châtillon. En cours de route, il continue à se dire qu’il aimerait bien savoir ce qui a contrarié ce plan, tout en appréciant que la direction de l’intrigue correspond au thème principal de ce cycle, le nomadisme de son personnage principal. L’artiste et le coloriste réalisent une narration visuelle encore un peu plus personnelle, alliant efficacité emportant la conviction et sens du détail bien placé, avec une élégance dans son exécution. Le lecteur se rend compte qu’il accompagne Gauthier de Flandres dans une quête spirituelle adulte, sondant la façon dont chaque individu vit les préceptes de la Foi, sans en oublier les dérives.