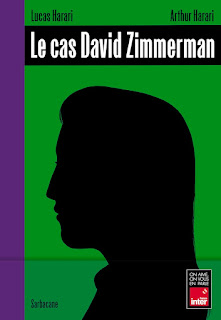Que peut-on deviner de quelqu’un par la seule observation de son appartement ?
Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre. Son édition originale date de 2024. Il a été réalisé par Lucas Harari pour le scénario, les dessins et les couleurs, coécrit avec Arthur Harari, et une aide à la couleur de Roman Gigou. Il comprend trois cent cinquante pages de bande dessinée. Lucas Harari est également l’auteur de L’Aimant (2017) et La dernière rose de l’été (2020).
Une photographie prise depuis une chambre à l’étage du pavillon : le père avec son fils d’une demi-douzaine d’années dans les bras en contrebas dans le jardin. Ce cadre est accroché au mur, à côté d’un meuble à rayonnage rempli de livres. Celui-ci est situé dans un angle, avec une fenêtre de part et d’autre. Sur le manteau de cheminée se trouvent une menora, un Rubik’s cube, une balle de baseball et deux autres bibelots. Sur la table de travail, un appareil photographique avec quelques bandes de négatifs. De la vaisselle sale dans l’évier, une platine de disques, un ordinateur avec, à côté, une assiette contenant un maigre relief de repas et une fourchette. David Zimmerman vient de finir de prendre sa douche, il essuie la buée sur le miroir, et se regarde, l’œil terne. Ici vit David Zimmerman, trente-quatre ans, photographe. Soudain, il sursaute, une grande silhouette habillée est apparue dans le miroir. C’est Harry Faugier, son meilleur mai, trente-six ans, peintre, qui a pris grand plaisir à lui faire peur. David le rabroue trouvant la blague de mauvais goût. Harry prend la bouteille de vodka dans le frigo et se sert un verre, en lui souhaitant : Lehaïm ! Il demande à son ami de se presser, ils vont être à la bourre. En attendant, il regarde les négatifs : le visage d’une jeune femme. Il demande à David si la jeune femme savait qu’il la prenait en photo. Puis il le complimente de manière ironique sur ses nouvelles chaussures. Ils sortent.
David et Harry se rendent à une soirée du nouvel an. Ils passent devant un sans domicile fixe assis par terre, et David lui donne une pièce. Ils remontent une avenue dans un quartier asiatique, jusqu’au métro. Pendant le trajet, ils papotent de tout et de rien : le progrès technique déprimant, la bouteille à acheter, le fait que David devrait porter des cravates. Ils arrivent au pied de l’immeuble et se rendent compte qu’ils n’ont pas le code. David appelle Alice pur qu’elle le lui donne. Ils montent au dernier étage pour accéder à un loft qui sert d’atelier au père d’Alexandre. Une fois à l’intérieur de la pièce aux grandes dimensions, bondée d’invités, ils croisent Judicaëlle que Harry salue, pendant que David va voir plus loin. Il retrouve Alice qu’il salue, et il lui fait remarquer qu’elle s’est coupé les cheveux. Harry les rejoint et il emprunte le portable de David pour passer une commande. Alice a apporté le cadeau de Noël de David, offert par la mère de celle-ci qui ne sait pas encore qu’ils se sont séparés. Un peu plus tard, Harry a été livré et il propose un cachet à l’un et l’autre, qui l’avalent.
Un épais volume, une lecture facile grâce à des dessins propres sur eux, de nature réaliste et descriptive, un peu simplifiés, avec des nuances plus sombres pour figurer l’ombre portée sur quelques surfaces. Le lecteur se rend compte qu’il tourne les pages assez rapidement, ne prenant pas forcément le temps de regarder chaque élément visuel, emporté par la compréhension immédiate de chaque case, par le flux régulier et doux de la narration. Il ne s’attarde pas trop sur la question qui ouvre le récit : Que peut-on deviner de quelqu’un par la seule observation de son appartement ? Dans le même temps, il voit bien que les deux premières planches montrent l’appartement de David, et il se demande si les auteurs mettent en doute ses capacités intellectuelles : oui, bon, d’accord, il faut qu’il regarde chaque endroit de l’appartement pour se faire une idée de qui est David Zimmerman. D’accord, il faut qu’il prête attention au visage sur le négatif. D’accord, le modèle de la nouvelle paire de chaussures de David doit être important. Visiblement les auteurs sont adeptes du principe dramaturgique de loi de conservation des détails, aussi appelée fusil de Tchekhov. Le lecteur doit faire une note mentale de chaque détail sortant de l’ordinaire sur lequel les auteurs attirent son attention, parce qu’il sera amené à jouer un rôle dans une scène ultérieure. Ça ne rate pas : David sera reconnu dans une scène d’émeute grâce à ses chaussures, l’emprunt de son téléphone par Harry va amener une visite de cet ami, etc.
Bon, d’accord, le lecteur fait attention à ces détails mis en avant par les auteurs, mais quand même il aurait pu le faire tout seul sans qu’ils soient ainsi pointés du doigt, comme s’il allait passer à côté… Sauf que le lecteur vient de se faire manipuler en beauté, ou en tout cas les auteurs se révèlent être d’élégants prestidigitateurs maîtrisant l’art de la diversion et de l’indice secret affiché au premier plan. D’un côté, le lecteur se fait des films dans sa tête avec un élément dont il suppute qu’il va jouer un rôle primordial par la suite, alors qu’il n’en sera rien. Ou bien il passe à côté d’un autre objet qu’il écarte comme purement décoratif, parce que trop éloigné de l’intrigue ou des situations précédentes. Alors, oui, la bouteille de vodka revient par la suite, toutefois la nature de l’alcool ne revêt pas d’importance particulière. Bon d’accord, le patronyme du personnage principal le qualifie comme juif, ce qui lui vaut d’être embauché pour réaliser les photographies d’un mariage de cette confession, une sorte de service rendu pour un autre. Et puis le lecteur oublie cette caractéristique… Du coup, il se dit que le discours de Gaby, la mère de David, plus de cent-cinquante pages plus loin, sort de nulle part. et il se souvient alors de la menora présente dans la première planche, au centre d’une case. Il s’installe ainsi une dimension ludique, le lecteur ayant conscience que les auteurs jouent avec lui, en lui faisant comprendre qu’ils jouent avec lui.
Quoi qu’il en soit, le plaisir de lecture est présent dès le début, avec cette promesse vite concrétisée d’une situation extraordinaire, riche de possibilité : David Zimmerman se réveille chez lui le premier janvier dans le corps d’une femme qu’il ne connaît pas, et sans souvenir de ce qu’il lui est arrivé. Le récit s’inscrit ainsi dans une forme de merveilleux fantastique, de conte. Le ton de la narration reste dans une forme de plausibilité concrète : pas d’humour graveleux sur la situation, mais un personnage principal désemparé, ne sachant pas comment réagir, se rendant compte qu’il lui sera impossible d’être cru par qui que ce soit. Le lecteur comprend qu’il va lui falloir un moment pour que David admette la situation. Il sent une forme d’impatience liée à l’anticipation, le désir de savoir ce qui va se passer, ce qui l’incite à conserver un rythme de lecture soutenu. Il lui faut un peu de temps pour se rendre compte que cela crée une forme de dissonance en lui : les dessins continuent de conserver une densité appréciable d’informations visuelles dans chaque case. Au point qu’arrive un moment où il se dit qu’il devrait consacrer plus de temps à la lecture des images, ralentir son rythme. Chaque action s’inscrit dans un environnement bien spécifique. Déjà, les auteurs lui avaient dit explicitement de prêter attention à l’aménagement de l’appartement, dès la première planche.
Ensuite, David Zimmerman habite à Paris : il est possible d’identifier certains quartiers comme le quartier asiatique, la rame de métro typiquement parisienne sur une ligne automatisée, les toitures en zinc, l’avenue de France, le boulevard Vincent Auriol au niveau de la station quai de la Gare, la rue de Belleville, le parc des Buttes-Chaumont, la gare de l’Est, la place de la Bastille et la colonne de Juillet avec le génie de la Liberté à son sommet, etc. Le lecteur peut également relever quelques inscriptions sur les murs comme Free Gaza, ou Plus jamais silencieuse. Il se rend compte que les environnements dans lesquels évoluent les personnages ont une incidence sur leur mode de vie, sur leurs activités, sur leurs déplacements. Cela devient patent quand David sort de Paris pour se rendre en proche ou moyenne banlieue, l’ambiance devient alors fort différente. Du coup, cela a pour effet de ramener le lecteur aux dessins, de consacrer un peu plus de temps à leur lecture. Il se produit un phénomène analogue avec le récit lui-même : il se laisse bercer dans un rythme agréable et facile, l’histoire de cet homme qui se retrouve perdu, sans savoir comment s’y prendre, tout en conservant l’objectif de retrouver son corps d’homme. Les séquences se suivent, accessibles, avec des enjeux très relatifs, des échanges très ordinaires entre les personnages. Et puis David retrouve Rachel Bluemen, cette jeune femme, serveuse au mariage juif qu’il avait photographiée. Le récit semble alors prendre une direction plus affirmée, l’attention de David se trouvant plus focalisée, et ses recherches devenant plus structurées, grâce à l’aide de Samia Hamza-Chauvet. Et tout s’achemine vers un dénouement en huit pages silencieuses, étrangement insatisfaisant et plat.
À ceci près que les auteurs n’ont pas promis un thriller avec une chute révélatrice pétrie de justice immanente : le rythme de lecture relève plus du roman naturaliste avec une touche de fantastique, cet échange de corps inexpliqué. Le lecteur relève bien le développement succinct de quelques thèmes en passant : le trouble de l’identité à l’évidence (et pas seulement sexuelle), la forme de solitude typiquement parisienne, les souvenirs qui font un individu et la limite de l’identité, l’altérité irréductible, le lien familial (par exemple entre mère et fils), l’étrangeté effrayante de l’autre (le cas de Christophe Karo et de sa relation avec sa sœur Sophie). Et le judaïsme. Page 204, Gaby, la mère de David, discute avec Samia pour lui expliquer l’origine du mot Hébreu. Cela fait sens dans le contexte, tout en surprenant un peu comme sujet de conversation. Elle explique qu’au départ, le mot Hébreu, ça veut dire Passer, Traverser… parce que c’était le peuple qui venait de l’autre côté du fleuve Jourdain. Donc, ce sont ceux d’en face : les autres. À l’origine, il s’agit sans doute d’un terme exogène mais par la suite les Hébreux l’ont aussi adopté. Ils se sont désignés eux-mêmes comme Ceux d’en face, Ceux qui viennent de l’autre côté. C’est très profond parce que ça induit que le Juif lui-même se définit comme un autre, qu’il porte son altérité en lui. Or ce récit parle exactement de ça : David est passé de l’autre côté (en devenant une femme), il est devenu autre, un étranger pour ses amis et sa famille, son propre corps lui est étranger, et il est un étranger dans ce corps. Ce dispositif narratif le place dans une situation où il porte littéralement son altérité en lui.
Une couverture des plus cryptiques, qui ne dit pas grand-chose : juste la silhouette d’un profil en ombre chinoise. Un récit qui commence par un événement fantastique : le personnage principal, un homme, se réveille dans le corps d’une femme. Une narration facile et fluide, grâce à des dessins très accessibles, et des scènes assez brèves très linéaires. Des auteurs qui jouent avec l’anticipation du lecteur et qui lui font savoir qu’ils jouent à ça. Un lecteur mis en confiance, sûr de lui car il a bien identifié ce dispositif. Une enquête prosaïque pour retrouver son corps originel, et quelques rencontres. Une mise en scène de l’altérité très pragmatique et factuelle, charriant des questionnements fondamentaux sur l’identité et la capacité d’adaptation. Troublant et fascinant.