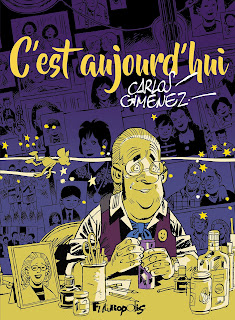T’as jamais rien compris au rock, Malc’ ! T’es un type de la mode, c’est tout !
Ce tome correspond à une biographie, celle Malcolm McLaren (1946-2006), homme d'affaires, producteur de disques et agent artistique britannique. Le scénario est de Manu Leduc & Marie Eynard, les dessins de Lionel Chouin, les couleurs de Philippe Ory. L’ouvrage commence avec une introduction d’une page écrite par Jean-Charles de Castelbajac. Il se termine avec un texte d’une page évoquant le retour de la paternité de la musique des Sex Pistols aux membres du groupe, les techniques initiées par McLaren (le buzz, la trash culture et le viral), la suite de sa carrière après ce groupe, le décès de McLaren et la destruction des archives et des objets du punk par son fils quarante ans après, et cinq pages d’étude graphique du dessinateur. Cette BD compte quatre-vingt-douze planches, et sa publication date de 2022.
En Angleterre dans les années 1990, Stuart conduit sa voiture sur une route côtière de nuit. Il s’arrête devant un bunker sur lequel a été peint le nom de McLaren : il dépose Malcolm, enchanté de découvrir que son père vit dans un bunker. Un chien retenu par une chaîne au mur leur aboie dessus. Un homme sort du bunker, le fusil à la main et demande qui se trouve là. Son fils répond en s’identifiant : Malcolm McLaren. À Londres en 1947, dans le salon de l’appartement de Rose McLaren, la grand-mère, Stuart, le petit frère, regarde vaguement le poste de télévision : plus d’un million à regarder passer le carrosse de la princesse Elizabeth, future reine d’Angleterre, le mariage fastueux avec le prince Philip Mountbatten retransmis à la télévision pour la première fois. Malcolm joue aux petits soldats, organisant une bataille sur la table basse. Peter McLaren sonne à la porte et indique à sa belle-mère qu’il est venu voir ses fils. Celle-ci le met à la porte sans ménagement l’informant que ces fils n’ont pas besoin d’un père escroc.
Londres en 1953. Le jeune Malcolm prend des leçons de piano : le professeur n’en peut plus des dissonances, sa grand-mère est tout sourire, sa mère souffre en silence. Le professeur rend son avis : il n’a jamais eu un élève qui massacrait la musique à ce point, il n’y a rien à en faire, désolé. Sa mère explique que Malcolm est atteint du syndrome de la Tourette, c’est pour ça qu’il a des mouvements si désordonnés. Une fois dehors, la grand-mère rassérène son petit-fils : il n’a pas d’autre syndrome que le talent pur. Il ne massacre pas la musique, il la dépoussière. Sa mère part vaquer à ses occupations en recommandant à Rose de ne pas le coucher trop tard car il va à l’école le lendemain. Une fois la mère éloignée, la grand-mère rassure Malcolm : sa mère est tellement vieille Angleterre ! Elle ne comprend rien, et Rose est sûr qu’il deviendra un artiste. Il en profite pour demander s’il faut vraiment qu’il aille à l’école, il trouve le maître trop autoritaire. La grand-mère répond qu’autant qu’il n’y aille pas : il faut toujours se méfier des gens autoritaires, ils veulent que rien ne change pour garder leur petit pouvoir. Malcolm lui demande pourquoi il y a autant de gens avec des télévisions ?
Le texte de la quatrième couverture explicite l’enjeu de cette biographie, en commençant par la devise de l’insolent manager des New York Dolls et des Sex Pistols : Mieux vaut un échec retentissant qu’une réussite médiocre. Viennent ensuite les questions : commerçant, artiste, provocateur, visionnaire, pitre génial ? Et la réponse : Malcolm McLaren était tout cela à la fois. Cette biographie s’attache à la période de sa vie allant de son enfance et son adolescence, de 1946 à 1965 en une dizaine de pages, pour développer la période de 1965 à 1979, c’est-à-dire la mort et les obsèques de John Simon Ritchie. Au travers de cette biographie, le lecteur assiste à la naissance du punk par celui qui est présenté comme en étant l’instigateur, et même le concepteur. Pour pleinement apprécier cette biographie, il vaut mieux que le lecteur dispose déjà de quelques repères basiques sur ce mouvement, comme l’importance des Sex Pistols, celle des New York Dolls, et quelques noms en tête comme Steve Jones, Vivienne Westwood, Marc Zermatti (1945-2020). Il goûtera encore plus aux saveurs du récit s’il est familier avec le contexte culturel de l’époque, par exemple les films de Russ Meyer (ce dernier apparaissant le temps d’une page), la carrière de Richard Branson, les morceaux des Sex Pistols et les autres groupes infréquentables de l’époque comme les Ramones, ou leurs héritiers comme Siouxie and the Banshees, le célèbre passage des Sex Pistols à l’émission de Bill Grundy. Il vaut mieux qu’il ait déjà entendu parler de Sylvain Sylvain, Nick Kent, Bernie Rhodes, Jaimie Reid, Wally Nightingale, Jean-Charles de Castelbajac.
Le récit commence en douceur par une courte introduction de Jean-Charles de Castelbajac qui loue les qualités de son ami : enfant du situationnisme et frère d’âme du mouvement viennois des actionnistes, créateur avec une vision transversale, une approche artistique du décloisonnement, le génie du détournement, c’est-à-dire un précurseur de l’hybridité des styles. La bande dessinée s’ouvre avec un dessin en pleine page montrant une route côtière, avec un encrage un peu rugueux, une composante descriptive qui incorpore du ressenti, sans rechercher une précision photographique. À sa manière, l’artiste respecte le principe de désacraliser la narration ou l’art. Il refuse d’astreindre ses personnages à des cadres rigides, en s’affranchissant des bordures de case. Il utilise des perspectives isométriques qu’il tord pour apporter un aspect de guingois à chaque endroit. Pour autant, il s’implique pour représenter des environnements conformes à l’Angleterre des années traversées. Le lecteur peut ainsi regarder les grilles qui bordent les entresols des immeubles sur le trottoir, l’intérieur d’une boutique de spiritueux, les pierres tombales d’un cimetière, un grand atelier d’artistes, des grands magasins en période de Noël, le magasin de fripes de Vivienne Westwood, le CBGB, des clubs minables où se produisent les Sex Pistols en Angleterre et dans les états du sud des États-Unis, les bureaux spartiates de la société de McLaren, le bureau luxueux d’un ponte d’EMI, le plateau télé de Bill Grundy, un quartier ensoleillé de Los Angeles, les grilles de Buckingham Palace, des aéroports, des hôpitaux, etc. En surface, ces décors semblent représentés avec désinvolture, avec parfois quelques inexactitudes sur le mobilier ou l’électroménager (pas forcément des modèles d’époque) ; dans le fond, le lecteur n'oublie jamais où l’action se situe, et il reconnaît au premier coup d’œil les sites célèbres.
Le dessinateur met en œuvre les mêmes principes pour représenter les personnages. Il se montre iconoclaste en simplifiant et en exagérant les traits de leur visage, en augmentant l’intensité des émotions, en leur donnant parfois des visages et des attitudes de gamins mal élevés et égocentriques. Difficile de prendre Malcolm McLaren au sérieux avec son nez en triangle pointu et sa chevelure volumineuse pleine d’arrondis enfantins. Dans le même temps, Lionel Chouin sait reproduire l’apparence des personnes connues avec fidélité, le lecteur les identifiant également du premier coup d’œil, sauf peut-être Nick Kent avec une astérisque pour une note en bas de page indiquant, dans un élan d’autodérision, qu’il n’est pas très réussi. D’un côté, ces dessins jouant avec la caricature ont tendance à neutraliser les éléments les plus sordides ; de l’autre côté, le lecteur habitué à ces caractéristiques visuelles voit bien que de nombreux actes sont réprouvés par la morale, voire parfois par le bon sens. Dans le même temps, les auteurs ne mettent pas en scène les symptômes physiques de l’autodestruction : par exemple, ils ne montrent pas le perçage par épingle à nourrice. Cette forme de contradiction devient une évidence en page 39 quand Malcolm fuit une descente de police, tel un personnage de dessin animé, tout en poussant le landau dans lequel se trouve son fils. Le lecteur peine à imaginer un adulte capable d’emmener son tout jeune fils dans une salle de concert où il a tout fait pour que ça dégénère.
Les scénaristes ont donc choisi d’adopter le point de vue de Malcolm McLaren pour raconter sa vie, de fait il apparaît comme le personnage principal, et comme le héros de sa propre vie. Il n’y a pas de questionnement moral sur sa façon de créer, ou tout du moins de se conduire en artiste. La première dizaine de pages établit quelques faits dans la jeunesse de McLaren, sans les monter en épingle comme expliquant tout son parcours d’adulte. Pour autant, libre de le faire, le lecteur relie par lui-même les points, que ce soit le situationnisme de Guy Debord, ou la séquence d’ouverture qui trouve sa conclusion à la fin et qui permet de considérer les motivations profondes de McLaren sous un autre angle, si cela sied au lecteur. La bande dessinée suit rigoureusement le fil chronologique de la vie de cet agitateur. Qu’il en soit familier ou non, le lecteur découvre une vision très cohérente de ce monsieur bien peu recommandable, mais à la vision artistique novatrice et d’une grande solidité. Un créateur intègre dans son œuvre, avec un égocentrisme en rapport pour pouvoir réaliser son œuvre. Au panégyrique dressé par Castelbajac, le lecteur est tenté d’ajouter de nombreux qualificatifs peu flatteurs, plus en cohérence avec la notion de grande escroquerie du rock’n’roll, que ce soit son comportement vis-à-vis de son fils (reproduisant ainsi le schéma de son propre père, d’une autre manière), sa façon de gérer les revenus financiers des Sex Pistols, de se déclarer seule véritable force créatrice du groupe, de leur coller l’étiquette de musiciens en-dessous de tout, ou de manipuler John Ritchie en flattant sa fibre autodestructrice jusqu’à la conclusion logique et inéluctable. Pour un lecteur qui n’entretiendrait pas d’admiration particulière pour cet individu, la bande dessinée apparaît globalement à charge.
Les Sex Pistols constituent une référence incontournable dans la culture populaire, que ce soit le slogan No Future, ou un comportement iconoclaste et autodestructeur sulfureux. Les auteurs montrent les coulisses en retraçant la vie de leur manager pendant ces années déterminantes. La narration visuelle apparaît également iconoclaste à sa manière, sans la dimension destructrice. Les choix opérés par les scénaristes donnent une impression d’évidence à chaque scène, que ce soit pour sa pertinence ou pour ce en quoi elle contribue à brosser le portrait de Malcolm McLaren. Les détails en passant finissent par produire un effet cumulé prouvant que les auteurs ont bien choisi un point de vue particulier qui apporte une dimension tragique et analytique à cet agitateur nihiliste.