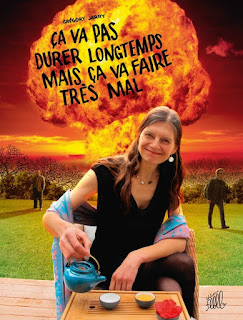Les mirages qui conduisent souvent à l’obsession, cette fille servile de la folie.
Ce tome fait suite à Croisade - Tome 4 – Les becs de feu (2009) qu’il faut avoir lu avant. Les quatre premiers tomes forment le cycle appelé Hiérus Halem. La parution de celui-ci date de 2010, et c’est le premier du second cycle appelé Nomade, qui compte également quatre albums. Il a été réalisé par Jean Dufaux pour le scénario, et par Philippe Xavier pour les dessins. Les couleurs ont été réalisées par Jean-Jacques Chagnaud. Il compte quarante-sept planches de bande dessinée. Il ne comporte pas de texte introductif du scénariste.
Son nom est El Hadj. Il est celui qui n’a jamais montré son visage. Son nom est El Hadj. Il est celui qui frappe sans pitié. La Croix comme le Croissant. Son nom est El Hadj. Il est celui qui commande aux assassins, à la secte des assassins. Son nom est El Hadj. Il se rend au-devant de celui qui vit au cœur de la cité morte. Un djinn au pouvoir redoutable, Ottar Benk. Son nom est El Hadj. Il rassure Ottar Benk ; personne, jamais, ne lui échappe. Ses hommes ne ratent jamais leur cible. À la tête d’un groupe d’assassins, assisté de son second le raïs, El Hadj traverse le désert à cheval, sur les traces de leur proie, des occidentaux qui n’ont plus d’eau. Quelque temps auparavant, El Hadj et ses hommes se trouvaient devant Ottar Benk qui leur confiait une mission : capturer le frère et la sœur, ne pas toucher à ce qui les accompagne, et surtout ne pas essayer de savoir de qui ou de quoi il s’agit. À la question de El Hadj, Benk répond que ce qui se trouve derrière les parois d’acier est la seule force au monde qui puisse faire revivre la personne dont il tient le portrait dans la main. El Hadj rassure son interlocuteur : personne, jamais, ne lui échappe.
Un peu plus loin dans le désert, la caravane menée par le frère et la sœur, Renaud de Châtillon et Vespera, peinent à avancer dans la chaleur sous le soleil. Le frère indique que la nuit va tomber et que la fraîcheur les ranimera. Il se retourne vers les soldats derrière lui et leur demande : la cage ? Un garde répond : plus rien ne bouge à l’intérieur. La sœur fait un geste du bras pour désigner des attaquants. Les flèches pleuvent : les soldats tombent à terre, morts. Un cavalier galope vers Renaud, armé d’une masse d’armes, avec laquelle il fracasse son bouclier. Il est arrêté par le raïs qui lui rappelle qu’il le veut vivant. Renaud est assommé par derrière, et les assassins s’emparent du chariot avec la cage métallique, ainsi que de la sœur, toujours vivante. Ils parviennent au caravansérail de Meg Halstar. Ils franchissent les portes de la cité. La jeune chrétienne tombe à genou à terre, à bout de force. Renaud essaye d’en appeler à l’aide des personnes présentes, en promettant mille ducats pour sa liberté, puis deux mille ducats, mais c’est peine perdue. Le raïs le confirme : personne ne viendra à son secours. Un homme au visage masqué par sa capuche approche, enjoignant Vespera à se relever, car une chrétienne ne doit jamais céder au désespoir. Il lui tend un bol d’eau. Un assassin s’approche pour l’arrêter, mais le chrétien ne se laisse pas faire.
Dans le tome précédent, le premier cycle se terminait avec Qua’dj atteignant les becs de feu, et Gauthier prenant ses distances d’avec la chrétienté et les croisés. Ce second cycle débute en revenant sur un autre personnage, El Hadj, et introduisant un frère Renaud de Châtillon, et sa sœur, Vespera, ainsi qu’une mystérieuse entité emprisonnée dans une grande caisse en fer. Le lecteur se rend compte que Renaud de Châtillon est un personnage historique, né vers 1120 et mort en 1187, parti pour la Terre sainte au moment de la deuxième croisade et y arrivant en 1147. Cela permet de dater le récit. Toutefois, le lecteur se souvient bien des choix des auteurs pour le premier cycle : il ne s’agit pas d’un récit historique, d’une reconstitution documentée et respectueuse, mais d’une fantaisie sur le principe des croisades, avec des noms changés, que ce soit pour les religions ou pour Jérusalem (modifié en Hiérus Halem) pour bien marquer la différence. La référence à Renaud de Châtillon s’apparente plus à l’intérêt que le scénariste lui a porté pendant ses recherches préparatoires. Les créateurs introduisent d’autres personnages : Lhianes une femme combattante, Czardann un chef au sein de la ligue des assassins, le mage Calfa, frère Alban. Il s’avère vite évident que ce second cycle continue l’intrigue du premier et que le lecteur doit l’avoir lu pour comprendre l’importance du portrait miniature qu’Ottar Benk tient dans main, le sens de la relation entre Osarias et Elysande la lumière des martyrs, ou l’identité de la jeune femme blonde qui apparaît dans l’avant dernière scène.
Par comparaison avec la fin du premier cycle, l’intrigue de ce tome se focalise sur un fil : le sort de la sœur et du frère, et le désir de possession qu’attise la mystérieuse entité incarcérée dans la caisse en fer. S’opposant à eux : la ligue des assassins sous l’autorité de El Hadj, un individu portant un masque, et mené par Czardann dans le dernier tiers du tome, exécutant une mission pour Ottar Benk, un individu lié à Gauthier de Flandres. Au cours du récit, certains personnages font une halte rapide à Hiérus Halem, mais il n’est question ni de X3 (l’équivalent du Christ), ni de la foi qui anime un camp et l’autre. De même, les croisades ne font pas l’objet d’un développement particulier, juste un état de fait en toile de fond. Le scénariste semble plutôt continuer dans la veine de la confrontation de Gauthier à des éléments culturels comme le djinn, agissant à la fois comme symbole de la différence de culture, à la fois comme la richesse de celle du Croissant fertile. Pour autant, il ne développe pas la dimension historique de la ligue des assassins, ou même le folklore associé aux djinns.
S’il a lu le premier cycle, le lecteur s’attend également à en retrouver des éléments visuels, en particulier ces pages en vis-à-vis qui se déplient pour former une vaste narration visuelle à l’échelle de quatre pages dépliées. Les auteurs ont abandonné cette particularité, peut-être à la demande de l’éditeur. Le lecteur en découvre une forme plus réduite, à l’échelle de deux pages en vis-à-vis, quand le Simoun Dja souffle à nouveau sur une armée, comme il l’avait fait dans le premier tome. En termes de découpage de planche, l’artiste la conçoit en fonction de la séquence : des cases de la largeur de la page pour disposer d’une vision panoramique sur les étendues du désert, des cases sagement alignées en bandes avec des bordures bien droites et bien nettes, une silhouette sur un cheval dont la tête dépasse de la bordure de la case, sur la case située dans la bande au-dessus ou une tête décollée qui saute hors de la case empiétant également sur la bande située au-dessus, une case sans bordure pour donner plus d’impact à la découverte du guerrier qui va combattre Gauthier, deux cases de la hauteur de la page quand l’entité s’extrait du corps de Vespera. Ces variations introduisent une diversité et un rythme dans la narration visuelle. Dans le même ordre d’idée, le dessinateur conçoit les plans séquences en fonction de l’action : des plans larges ou des plans rapprochées, une séquence occupant plusieurs cases d’affilée pour une décomposition vive et rapide d’une succession de gestes, ou des cases plus éloignées dans le temps pour une action plus longue.
Le lecteur retrouve cette narration visuelle efficace et un peu sèche, avec une mise en couleurs apportant de nombreux éléments visuels à chaque case. Jean-Jacques Chagnaud effectue un travail impressionnant, relevant également de la narration visuelle : textures de sable, de métal, de peau, de pierre, de tentures. Continuité d’une ambiance au cours d’une séquence, et de l’impression générée par les décors, même si ceux-ci ne sont pas dessinés pour que la lecture s’accélère et donne la sensation d’une action rapide. Dans le même ordre d’idée, le lecteur constate que le dessinateur investit du temps pour réaliser des cases comportant plus d’informations visuelles : les détails des vêtements et des armures, des décors naturels et des habitations humaines. Le lecteur se rend compte qu’il ralentit son rythme de lecture à plusieurs reprises pour mieux regarder une case ou un passage : le trône richement ouvragé sur lequel siège Ottar Benk, les pièces d’armure des assassins, la cité construite dans un site rocheux, la salle dans laquelle le mage Salta reçoit (sans oublier ses courtisanes), le duel entre Lhianes et Gauthier de Flandres, leur réconciliation sur l’oreiller, l’infestation de Vesperine, la deuxième tête qui vole, l’avancée du Simoun Dja sur les soldats, les habitants en train de condamner les ouvertures du caravansérail Meg Halstar, les tentes précaires au pied des murailles de Hiérus Halem.
Séduit par la variation subtile sur les croisades, l’opposition entre deux fois, et la découverte d’une culture étrangère par ses mythes, le lecteur revient bien volontiers pour découvrir ce qu’il advient de Gauthier de Flandres, l’un des personnages principaux du premier cycle. La narration visuelle a encore gagné quelques degrés de qualité, que ce soit dans le niveau de détails, ou dans l’élaboration des plans de prise de vue, un plaisir de lecture. Pour ce second cycle, l’intrigue se resserre sur quelques personnages et un fil d’intrigue principal, tout en capitalisant sur les éléments installés dans le premier cycle. Gauthier de Flandres apparaît plus libre que jamais, tout en continuant de subir l’influence du pays dans lequel il séjourne.